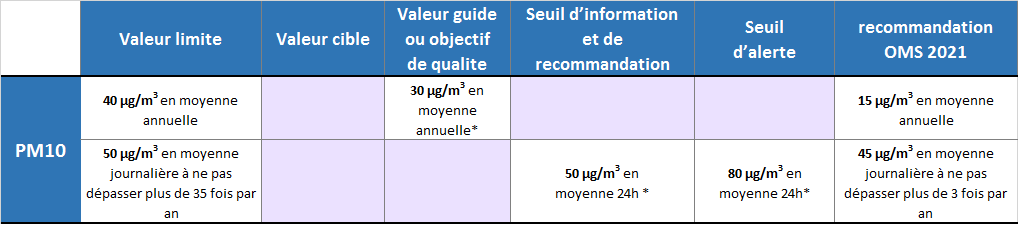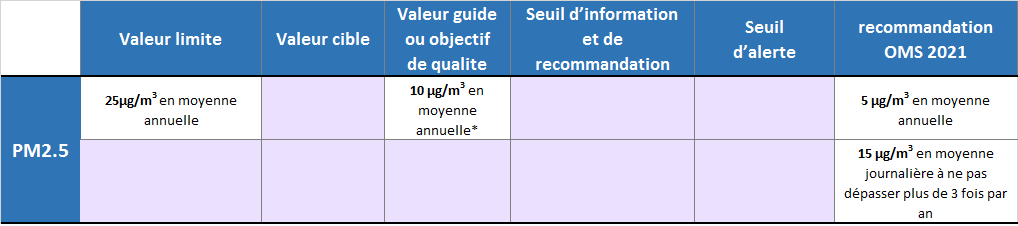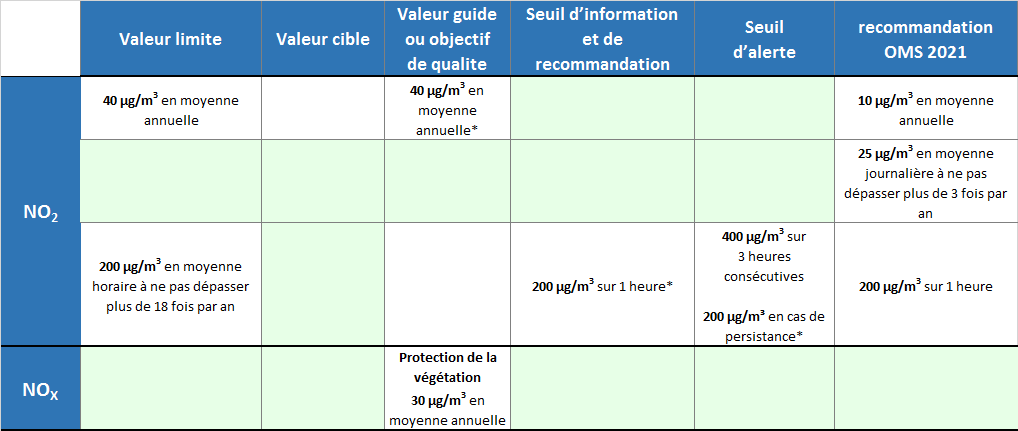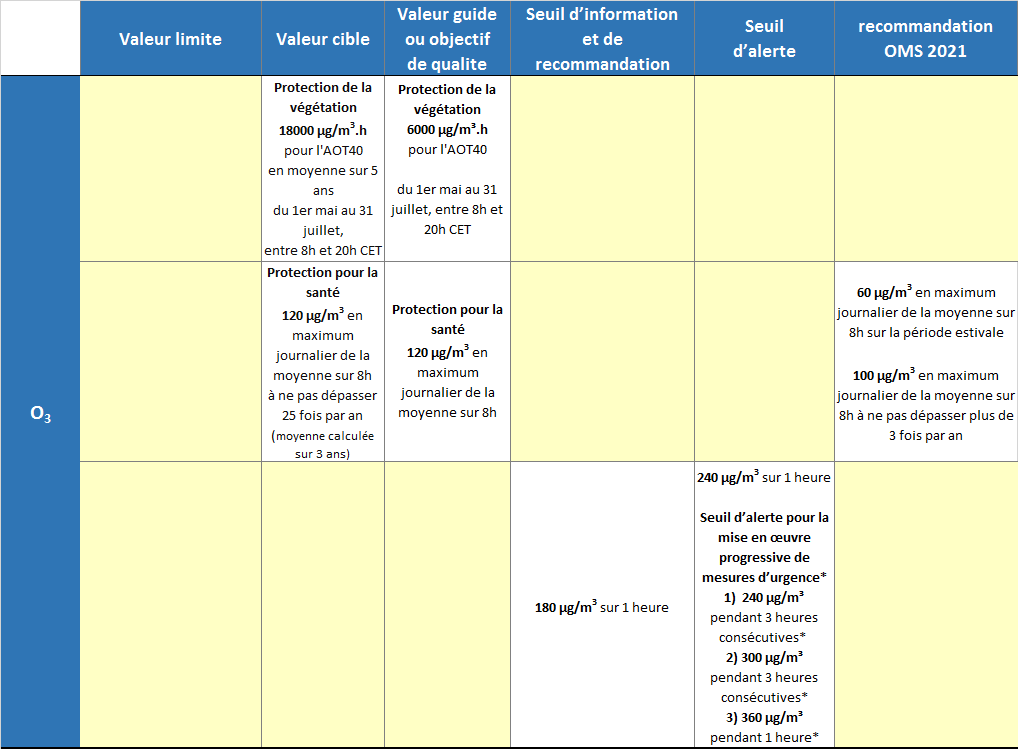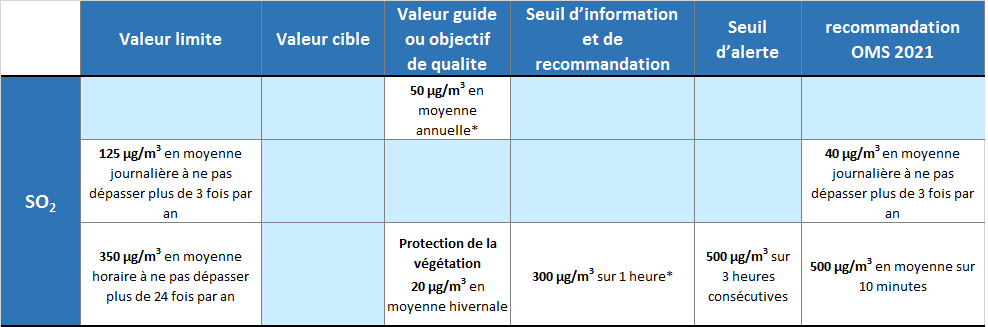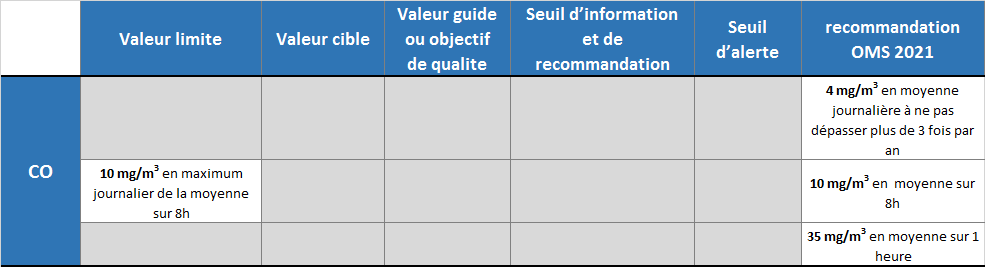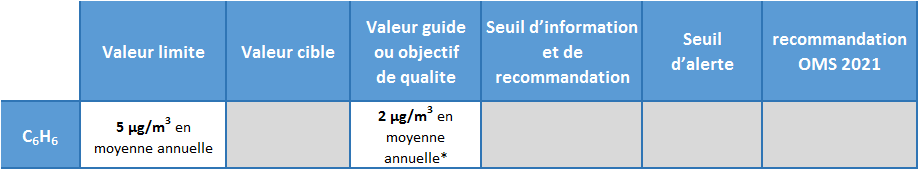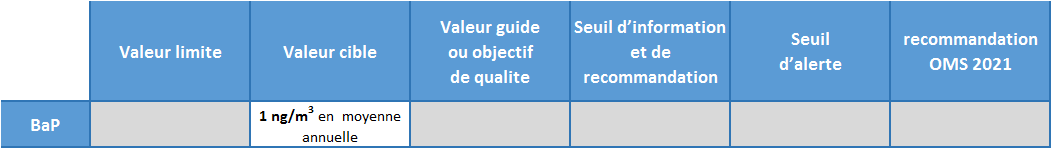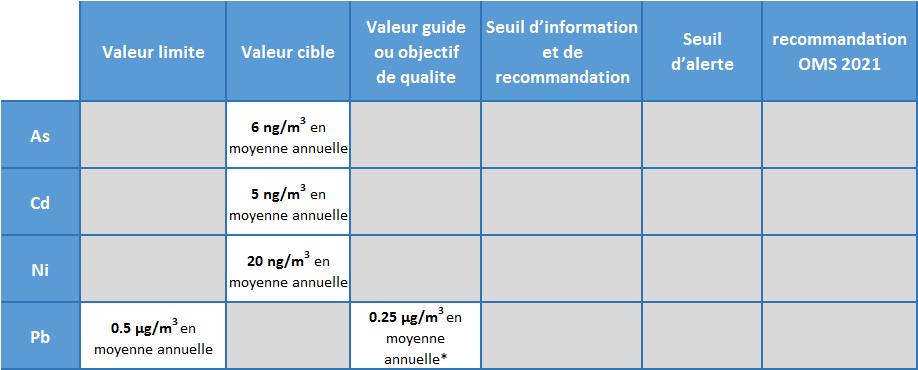Les normes en matière de protection de l’atmosphère peuvent paraître complexes car nombreuses.
Elles concernent divers domaines :
- l'air du lieu de travail,
- l'air ambiant extérieur,
- l'air rejeté par certaines installations (industries, automobiles... : on parle dans ce cas d’émission),
- l'air intérieur (public ou privé).